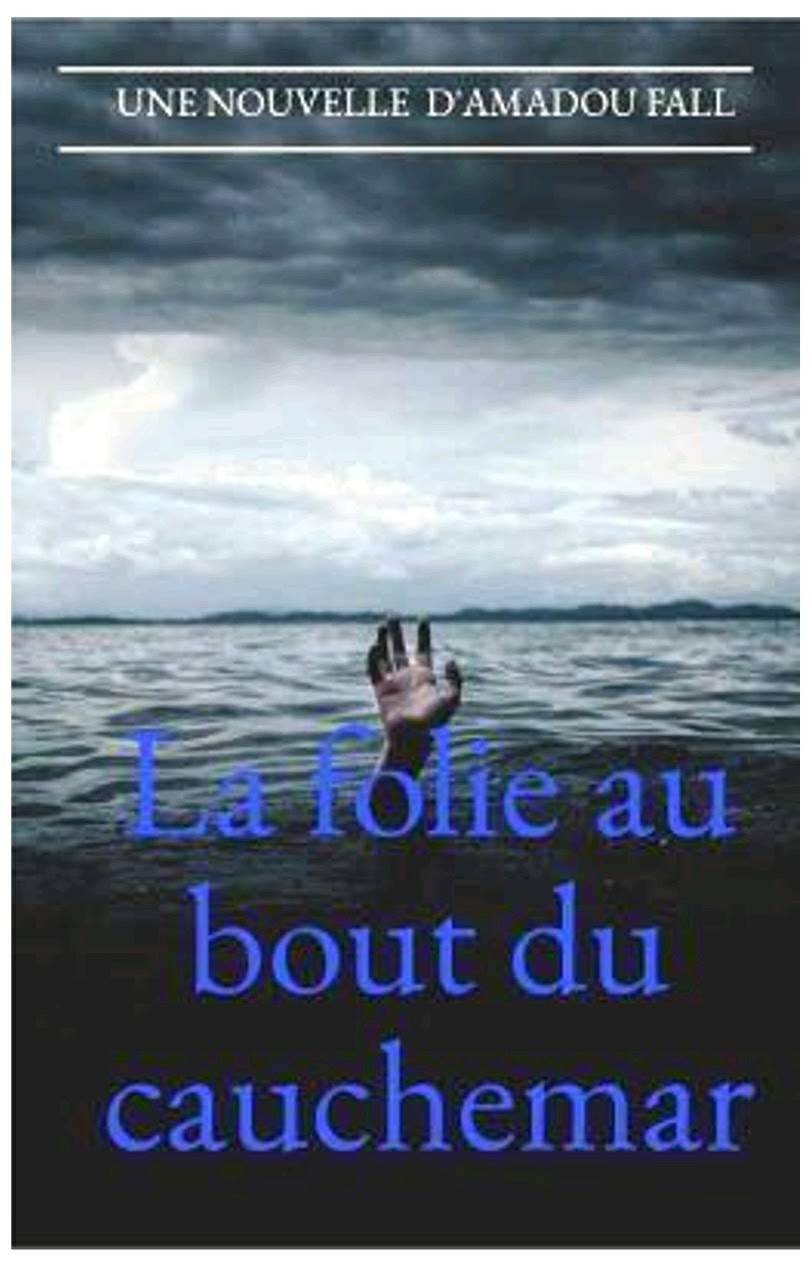La folie au bout du cauchemar... *- Par Amadou FALL *
Sinistre comme le râle étouffé d’une bête agonisant sous la lame pressée et aveugle d’un boucher voleur de bétail, le cri déchira le silence de la nuit, à plusieurs reprises. C’était toujours à la même heure qu’il se déclenchait, à minuit tous les soirs, depuis un mois. Lugubre à vous glacer le sang, il était entrecoupé de gutturales vociférations contre les démons du désert, des mers que l’homme derrière la voix accusait de tous ses tourments.
A Mirabelle, un quartier parmi les plus déshérités des plus sordides banlieues de Makobar, le voisinage de la mansarde d’où s’élevaient ses ululements et plaintes nocturnes, fut pris dans une indescriptible frayeur, le premier soir de leur explosion soudaine et brutale. Dans cette lointaine cité-dortoir suburbaine, les gens qui partaient tôt au travail ou pour en chercher au centre-ville et alentours et qui en revenaient tard, n’avaient rien de plus précieux que leur sommeil. Ce temps de récupération était essentiel à la réparation en eux des virulents dégâts de longues et pénibles journées de labeur sous un soleil de plomb.
Massékou Bengue était cet homme qui ululait toutes les nuits, et plus fortement encore les soirs de pleine lune. Le jour, il était une menace de mort pour ses congénères, quand il lui arrivait d’échapper à la surveillance des siens.
Ailleurs, dans les quartiers huppés de la Haute ville et les banlieues chics de la Rivera, de la Marina, sur bord de mer et des alentours de l’Aéroport international Patrice Lumumba, on aurait vite fait de porter plainte contre tiers pour troubles à la quiétude nocturne et atteinte à l’ordre public et demandé à la maréchaussée de sévir. Là-bas, on pouvait habiter le même pâté de maisons, partager le même pallier, des années durant et se croiser quotidiennement sans se saluer, sinon par un hochement distant de la tête, faute de se connaître ou de vouloir se connaître. Sans état d’âme...
A Mirabelle, passée la stupeur des premiers moments, la compréhension et la solidarité avaient vite fait de reprendre leurs droits. Ici, les pétages de plombs, les accès de folie rendus fréquents par les heurts, peines et douleurs qui emplissaient les jours et les nuits du bourg étaient couverts du voile pudique de la commisération par des hommes et des femmes unis par le sang, l’amitié et la fraternité, sur la toile de fond d’une innommable misère partagée.
Massékou était, il n’y avait guère longtemps, le plus courtois, affable, serviable et respectueux des aînés, parmi tous les jeunes gens de Mirabelle. Il était bien normal, pour tous, de s’apitoyer sur sa situation et ses malheurs présents, de faire preuve de la plus grande compréhension et de prier pour qu’il redevînt celui qu’il avait été et qu’on regrettait qu’il ne fût plus.
Sa mère, Assita Bambado, avait perdu l’embonpoint caractéristique des femmes de son ethnie. Elle avait beau être forte physiquement et mentalement, mais la désillusion et le désespoir qui la rongeaient depuis la démence de Massékou l’avaient rapidement fait fondre.
* * *
La cinquantaine, Assita était la veuve d’un ouvrier du bâtiment très tôt disparu. Il n’avait laissé derrière lui le moindre héritage, sinon trois enfants, deux garçons, Massékou et Ngouda, et une fille, Fabineta. Elle n’avait de revenu autre que les maigres bénéfices qu’elle tirait de son étal au marché, pour faire bouillir la marmite, donner à manger à la maisonnée, au moins une fois dans la journée.
Massékou était l’aîné de la famille. Le garçon acquit un semblant de métier, en usant ses fonds de culottes sur les chantiers où son père travaillait de son vivant. Il s’en sortit avec une maîtrise empirique de la maçonnerie. C’est sur ses compétences-là que la famille avait fondé de grands espoirs de survie, de lendemains moins sombres et pénibles.
Sur les traces de son défunt père, Massékou avait alors continué de se lever à l’aube pour traîner ses guêtres à travers la ville, à la recherche d’une embauche, ne serait-ce que pour une journée de labeur. Mais il se faisait éconduire, à chaque fois qu’il se présentait aux abords des chantiers de construction de plus en plus rares à être actifs. Signe extérieur patent de la profonde crise économique que traversait le Muntuland, le bâtiment n’allait plus...
L’étouffant marasme qui sévissait alors n’épargnait aucun domaine d’activité. Il exacerbait le chômage endémique qui tourmentait une population massivement jeune, qu’elle fût instruite, diplômée ou pas.
Le travail faisait d’autant plus fortement défaut à Makobar que la récession et une sécheresse qui perdurait avaient abruptement rompu le mouvement pendulaire des migrants saisonniers entre les campagnes et la capitale. Parce qu’aléatoire et ingrat, l’hivernage ne faisait plus retourner à la terre les milliers et les milliers de jeunes paysans qui, jusqu’alors, venaient séjourner en ville, tout juste durant la saison sèche, pour quelques menus boulots dont n’avaient jamais voulu les citadins de souche.
La crise en était arrivée à un degré de prégnance tel que nul ne faisait plus la fine bouche. Un nombre incroyable d’individus, toutes origines sociales confondues, se bousculait pour la moindre tâche qui pouvait rapporter quelques danks [la monnaie du pays, le Muntuland]. La soupape de sécurité que constituait l’auto-emploi à travers l’artisanat, le commerce informel et la débrouille en tout genre, étouffait sous son trop-plein, menaçant d’exploser à tout instant.
Pour un nombre croissant de jeunes, partir ailleurs s’imposait, à eux comme à leurs parents, quel qu’en pouvait être le prix à payer.
L’émigration fut alors un viatique qu’empruntaient toujours plus de jeunes, à défaut de pouvoir se battre sur place pour la dignité humaine que confère le travail.
La pauvreté dans le désœuvrement est un fardeau lourd à porter. Elle est la source d’une désespérance qui peut conduire au pire, à accepter le pire en croyant ou espérant pouvoir s’en sortir et tendre une main prodigue et bienfaitrice à ceux qui vous sont les plus chers. «Partir, quitte à en mourir...», disaient-ils.
Ainsi, serrés comme des sardines sur de frêles embarcations, défiant les furies océanes, ils furent de plus en plus nombreux à prendre les chemins de traverse, «hors du charnier natal, fatigués de porter leurs misères hautaines », «ivres d’un rêve héroïque et brutal», mais pour l’Europe à l’inverse des conquistadores décrits par Jose-Maria Heredia dans un de ses poèmes épiques . Comme eux, ils étaient à la recherche de cet Eldorado mythique, «aux bords mystérieux du monde occidental». Eux aussi voulaient faire fortune ailleurs, «conquérir le fabuleux métal que Cipango murit dans ses mines lointaines». Eux aussi espéraient des lendemains meilleurs, dans les pirogues qui les emportaient au-delà de l’Atlantique, «l’azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantant leur sommeil d’un mirage doré ».
Mais le réveil de ces conquérants de la misère était presque toujours brutal. La plupart n’arrivaient jamais à destination, contrairement à ce que laissaient accroire les appels téléphoniques arrangés par les passeurs véreux qui organisaient leur traversée, au motif de fallacieuses rumeurs sur l’opulence de l’offre de travail sur l’autre rive. Les clandestins qui prenaient la mer étaient nombreux à s’y noyer, à arriver, sur les plages espagnoles, italiennes ou grecques, premières étapes hasardeuses de leur destination européenne, sans vie ou dans un état comateux qui ne leur permettrait même plus de continuer à construire … des châteaux en Espagne.
Les échos que les jeunes candidats à l’exil avaient de ces fins malheureuses et tragiques leur importaient peu. Dans leur fébrile expectative, sur les rives africaines, ils n’entendaient point mettre leurs rêves d’ailleurs sous l’éteignoir. Massékou Bengue avait été de ceux-là...
* * *
Le fils aîné d’Assita Bambado ne savait pas nager et abhorrait la mer. La première fois qu’il avait été mis en contact avec elle, sur une plage où il avait été traîné par des amis d’enfance, il avait de justesse échappé à la noyade. Il y avait bien longtemps. Il en avait gardé une phobie viscérale pour cette immensité bleue qui lui faisait déjà autant peur que la solitude dans une nuit noire.
Sa mère était bien au fait de tout cela. Ce fut d’ailleurs en connaissance de cause qu’elle n’avait point voulu que son fils suivît d’autres jeunes de son âge qui avaient pris le large vers l’Europe sur des pirogues à moteur. Elle avait été trop affectée, traumatisée même, par les récits récurrents des naufrages meurtriers qui abrégeaient épisodiquement ces périlleux sauts vers un inconnu supposé et espéré meilleur. Elle avait voulu un tout autre viatique pour le fruit de ses entrailles.
Pour cela, Assita Bambado avait hypothéqué ou vendu les maigres biens qui lui étaient propres. Elle avait d’abord mis au clou le collier, les bracelets et les boucles d’oreilles en or primitif du Bambougou qu’elle avait hérités d’une tante maternelle et longtemps gardés dans un petit coffret en bois imputrescible secrètement enterré sous son lit.
La plupart des Muntulandaises, surtout celles d’un âge avancé comme elle, avaient une conception plus utilitaire qu’esthétique des bijoux. Elles ne possédaient et ne conservaient de parures que dans la perspective de pouvoir les valoriser pour faire face à un coup dur, une situation extrême, un jour ou l’autre.
La mise en gage de ses vieilles mais précieuses parures chez Abou Samasse, un des plus véreux et sournois usuriers de la capitale, avait à peine rapporté à Assita six cent mille danks, soit environ neuf cents euros, au cours d’alors de la monnaie du Muntuland. Mais il en fallait davantage, quatre cent mille danks de plus, pour qu’elle arrivât à ses fins : rassembler le million de danks - mille cinq cents euros - qu’on lui avait dit qu’il fallait qu’elle donnât à son fils, pour qu’il pût rallier l’Allemagne. Non pas par les airs, faute de visa, ni sur les houleuses eaux atlantiques craintes par-dessus tout, mais par monts et par vaux, à travers le Sahara, puis la Grèce et les Balkans, après une courte traversée par ferry de la Méditerranée que l’on disait sans danger.
Un million de danks ! De sa vie déjà longue, Assita n’avait jamais tenu entre ses graciles doigts pas même le cinquième de cette somme faramineuse. Mais il la lui fallait absolument. Elle était au milieu du gué. Pour franchir le Rubicon, elle vendit un petit lopin de terre qu’elle possédait à Niangara, son village d’origine, se fit exceptionnellement verser le produit mensuel de la tontine du marché, alors qu’elle était encore loin sur la liste d’attente. Elle s’endetta également auprès de parents, amis et voisins acquis à sa cause, au grand espoir de réussite placé en son fils, Massékou Bengue.
* * *
Ils étaient partis dans la fraîcheur d’une nuit évanescente, entre chien et loup, à bord d’un camion militaire réformé, mais remis à neuf et gonflé pour se jouer des écueils et chausse-trapes de l’immense désert. Ils étaient vingt jeunes, dont cinq filles. Deux jours avant leur départ, ils avaient tous payé, rubis sur ongle, au bedonnant opérateur économique qui avait affrété le véhicule, et le prix de la traversée jusqu’à Tripoli pour cinq cents euros, et celui du passage de la Méditerranéenne pour mille euros.
N’eût été le désistement, à la dernière minute, d’une candidate au voyage, Massékou n’aurait pas fait partie de cette équipée. Il aurait sans doute attendu des mois avant de pouvoir faire le grand saut. Il avait mis ce contretemps en sa faveur sur le compte de sa bonne étoile, convaincu que c’était de bonne augure.
Spontanément, les jeunes gens avaient commencé à se parler et à chahuter dans la cohue des adieux avec les parents et amis, à leur départ de Makobar. Les uns et les autres avaient davantage fait connaissance durant le franchissement de la moite forêt primaire muntulandaise qui perdait de sa luxuriance, au fur et à mesure qu’ils cinglaient vers le nord. De petits groupes s’étaient spontanément formés, consolidant des affinités anciennes et connaissances nouvelles transcendant les origines et les appartenances familiales, ethniques et sociales.
Massékou Bengue, Ourouma Ndaye et Massogui Sala s’étaient de la sorte liés d’amitié. Ils étaient tous trois ouvriers du bâtiment, l’un maçon et les autres charpentiers-coffreurs. Avec toute la fougue de leur jeunesse, ils s’étaient juré solidarité et aide réciproque face à l’adversité, en tout lieu et à tout moment, durant leur odyssée qu’ils savaient particulièrement périlleuse.
Les premiers jours avaient été sans anicroches. Au bout de quelque huit cents kilomètres tranquillement franchis, ils avaient laissé loin derrière eux la forêt dense mais de plus en plus marquée par les stigmates du pillage de ses essences précieuses, traversé une savane aride et broussailleuse et atteint la lisière méridionale de l’immense et terrifiante mer de sable. C’est là que les choses sérieuses allaient commencer...
* * *
Moulaye Idrisse, l’homme qui avait la charge de conduire Massékou Bengue et ses compagnons jusqu’à l’horizon le plus proche du monde occidental, en était à sa toute première mission du genre. Il avait certes été «chauffeur en second», mais sur d’autres pistes moins difficiles et vers d’autres destinations moins aventureuses. Pour ce baptême du feu, il lui avait été donné l’ordre strict de suivre, à la trace et à bonne distance, un «vétéran de la route du désert» qui, comme lui, faisait cap sur Tripoli, première rupture de charge des cargaisons humaines qu’ils convoyaient tous deux.
Alors que, sous un soleil de plomb, leur véhicule peinait à se hisser au sommet d’un erg, ses roues patinant rageusement dans le sable mouvant, Massékou et ses compagnons entendirent comme un tonnerre percuter et rompre, en trois coups rapprochés, le silence du désert. Du haut de la montagne de sable, ils aperçurent, à quelques encablures de là, ce qui restait du camion qu’ils suivaient. Il avait explosé en mille morceaux. Partout autour des restes du véhicule et des bagages en fumée, des cadavres en lambeaux, et pas un seul signe de vie.
L’auto avait sauté sur au moins trois de ces nombreuses mines posées à travers le désert par des bandits de grands chemins qui étendaient insidieusement et violemment leurs hideuses tentacules, de la partie septentrionale du continent au Sahel plus au sud. Profitant du chaos qui prévalait dans cette immensité, depuis la chute mortelle du colonel Mouamar kaddafi, ils s’étaient lourdement et massivement armés.
Ces djihadistes trafiquaient des armes et de la drogue. Ils prenaient des otages occidentaux qu’ils libéraient en échange de fortes rançons payées par des Etats qui s’en défendaient, officiellement. Ils razziaient et semaient la mort à tout vent, même dans les rangs innocents de leurs frères et sœurs en religion. Ils perpétraient leurs odieuses et sanguinaires forfaitures et crimes, paradoxalement sous l’étendard de l’islam, une religion d’amour et de paix.
Les passagers du camion qui suivait avaient mis pied à terre, arrivés au bas de l’erg. Devant l’horreur qui s’étalait sous ses yeux qu’il avait vite fermés, Massékou tremblait de tout son corps, sous l’emprise de l’effroi et du désarroi. Jamais il n’avait imaginé vivre pareille abomination.
Alors que des gaillards s’étaient spontanément portés volontaires pour donner une sépulture la plus décente possible aux morts, il avait rapidement regagné le camion presque à tâtons, pour s’y engoncer avec les quelques femmes qui faisaient partie du voyage. Comme elles, sinon encore plus qu’elles, il était en prise à une indescriptible frayeur. Il suait à grosses gouttes, pas seulement à cause de l’étouffante chaleur qui régnait. Le choc subi avait mis à nue sa fragilité et sa vulnérabilité.
Par chance, aucune des bandes de djihadistes qui écumaient cet espace de désolation ne s’était pointée sur les lieux de l’accident. Sinon, comme à leur détestable habitude, ils auraient délesté de leurs argent et biens les voyageurs trouvés sur place, morts ou vifs, violé et ravi les femmes.
* * *
Le camion rescapé avait repris la route, peu avant le crépuscule. Salem Abasse, son chauffeur en second, après de longs conciliabules, était venu à bout du refus Moulaye Idrisse de reprendre la route. Fort de l’expérience de deux ou trois traversées à son actif, il avait juré qu’il était en mesure de le guider sans problème.
L’insistance des voyageurs avait aussi pesé sur la décision de Moulaye Idrisse. Pour ces gens à qui il ne restait plus que l’argent qui leur était indispensable pour la partie européenne de leur long périple, il n’était absolument pas question de rebrousser chemin. Ils avaient préféré continuer à risquer leur vie plutôt que de revenir piteusement à leur misérable case-départ.
A peine avaient-ils quitté les lieux de l’accident que la nuit tomba abruptement, couvrant le désert de son immense manteau noir. Moulaye Idrisse et son second avaient maintenu le cap vers Awbari, une des premières étapes en terre libyenne, ce qui était censé être les lointaines lumières de la ville leur servant de point de repère.
Ils avaient roulé toute la nuit, sur une route tantôt sablonneuse tantôt rocailleuse. Au lever du jour, ils s’étaient rendu compte, qu’ils avaient le dos au soleil. Ils n’étaient pas sur la direction nord-est, vers la Libye, mais quasiment à l’opposé, toujours en territoire algérien, en aval d’In Guezzan.
L’équipée s’était perdue dans le désert. Elle s’était retrouvée aux confins occidentaux du Hoggar avec ses plateaux cristallins tels de sombres îlots sur un océan de sable ocre. Elle venait de parcourir près de mille kilomètres, mais dans le mauvais sens. Elle n’avait eu d’autre choix que de rebrousser chemin, de refaire ainsi deux fois plus de route que prévu pour rallier l’étape première d’Awbari.
Arriva ce que tout voyageur craint le plus : la panne sèche, au milieu de nulle part. La frontière libyenne à peine franchie, le camion s’était soudainement mis à hoqueter et à se cabrer, comme si son moteur s’étouffait. Et c’était bien le cas. Il avait brûlé les derniers litres de gasoil contenus dans les six jerricans accrochés à ses flancs au départ de Makobar.
Moulaye Idrisse n’avait pas eu la présence d’esprit de renforcer ses réserves dès son entrée en terre algérienne où le carburant était d’ailleurs beaucoup moins cher qu’au Muntuland. Il n’avait envisagé le faire qu’à Awbari, puisqu’il disposait, a priori, de suffisamment de gasoil pour arriver jusqu’à cette étape libyenne du périple. Mal lui en avait pris.
Au comble du désespoir, les migrants en perdition avaient longuement déversé leur bile sur le chauffeur et son second. L’ambiance redevint plus sereine. Faute de mieux, ils avaient fini par accepter d’attendre sur place que le ciel leur tende une main secourable, par le canal d’un convoyeur qui pourrait les dépanner en gasoil et les guider jusqu’à la prochaine étape.
Mais les pistes du désert ne ressemblent en rien à des autoroutes. Les véhicules passant par mois là où ils étaient se comptant sur les doigts d’une seule main, ils y étaient restés longtemps à se ronger vainement le frein. Six jours et six nuits, alternant canicule infernale et froid extrême, sans voir arriver âme qui vive. Au septième matin, il ne subsistait plus grand chose de leurs maigres provisions.
Se donnant des airs de capitaine courageux bravant la tempête sur un navire qui sombre inexorablement, Moulaye Idrisse avait convaincu ses passagers de poursuivre à pied. Il leur avait fait miroiter une chance de trouver de l’aide dans l’oasis le plus proche. Ils le laissèrent sur le bivouac, à l’ombre de son véhicule, avec la compagnie de son second.
Moulaye serait bien parti avec Massékou et les autres. Mais il gardait encore l’espoir d’être dépanné. Il avait, par dessus tout, peur des représailles de son employeur, si jamais il s’en sortait, après avoir abandonné le camion à la merci des pillards du désert qui vous cannibalisaient un véhicule aussi vite et net qu’un cadavre sous les serres d’une bande de charognards affamés.
* * *
Les voyageurs avaient attendu la tombée du jour pour lever le camp. Le froid nocturne leur était d’autant plus difficilement supportable que les vêtements légers qu’ils portaient leur étaient de nulle protection contre le vent glacial qui s’était subitement mis à souffler. Mais la nuit leur avait paru meilleur guide. Tous les soirs passés au bivouac, elle leur avait fait entrevoir l’espoir de retrouver la civilisation, dans le halo lumineux qu’elle laissait se détacher, au loin. Pour eux, cela ne pouvait être que les lumières d’Awbari. Ils n’avaient qu’à faire à nouveau cap sur le lieu-dit qu’elles leur indiquaient.
Ils avaient marché toute la nuit. Mais, plus ils avançaient, s’en approchant apparemment, plus les lumières du bourg restaient dans le lointain. Tombant de fatigue, ils s’étaient finalement arrêtés au petit matin, sur le bas-côté de la piste suivie, afin de reprendre des forces.
Le soleil était haut dans le ciel, un ciel bleu azur sans le moindre nuage qui pût atténuer son ardeur, au moment où les voyageurs se décidèrent de reprendre la route, dans la fournaise. C’était pure folie.
Cinq jeunes gens, dont deux filles, rendirent d’ailleurs l’âme, une cinquantaine de kilomètres plus loin, morts par inanition. La faim et la soif qui rongeaient tout le monde, depuis l’épuisement des réserves en nourriture et en eau, leur avaient été fatales.
Ourouma Ndaye et Massogui Sala avait continué à soutenir fraternellement Massékou Bengue du mieux qu’ils pouvaient. Il était physiquement plus résistant que ses compagnons d’infortune qui venaient de perdre la vie. C’est plutôt sa tête qui n’était plus solide.
L’impact traumatisant que l’explosion meurtrière du premier camion avait eu sur son esprit avait été aggravé par ces longues journées et nuits d’errance sans issue dans le désert. Outre la faim, la soif et un soleil de plomb, la désolation, l’angoisse et le désespoir avaient encore plus endommagé sa tête, fait qu’il n’était plus lui-même.
Il avait quasiment cessé de dormir la nuit. Il était tenu en éveil par des voix et hurlements d’outre-tombe que lui seul percevait, alors que tout autour régnait un silence de cathédrale.
L’après-midi où leur marche forcée avait été à nouveau endeuillée, il s’était, à un moment donné, subitement mis à courir, criant à tue-tête : «Dieu est avec nous ! Nous sommes enfin arrivés à Tripoli ! Tripoli nous voilà ! Tripoli nous voilà ! Dieu soit loué, mes amis !»
Ses compagnons d’infortune le regardaient, éberlués, mais surtout inquiets de le voir délirer de la sorte.
Lui s’étonna de leur manque d’enthousiasme face au magnifique spectacle que la capitale libyenne offrait à leurs yeux, en fait à ses seuls yeux. Massékou vivait seul son mirage, dans son fol esprit. Il délira longtemps avant de s’évanouir...
* * *
Quand Massékou Bengue se réveilla, beaucoup d’heures après, il fut fort surpris de se retrouver sous une tente bédouine, couché à même le sol, sur un tapis en peau de mouton rembourrée. Sa fièvre était tombée. L’air qui lui parvenait du dehors était d’une très agréable fraîcheur.
Il était avec ses compagnons au cœur d’une des nombreuses oasis paradisiaques s’étendant sous les falaises du Messak, à peu de kilomètres d’Awbari. Lui et les camarades avec qui il était dans la même galère à la dérive sur l’océan de sable et de roche, avaient été sauvés et amenés là par des caravaniers. L’oued était leur fief tribal, depuis des temps immémoriaux.
Quand ils se furent rassasiés de lait de chamelle et de succulentes dattes, et bien reposés, le Cheikh Mahmoud Ben Abdallah vint leur rendre visite. Le Cheikh était l’émir, le commandeur respecté de cette communauté bédouine sédentarisée, mais encore nomade, caravanière pour les besoins d’échanges commerciaux qui lui étaient vitaux. Il entama la conversation autour d’un thé à la menthe.
- « Salam alikoum», que la paix et la félicité soient sur vous qui êtes nos hôtes. D’où venez-vous, et quelle est votre religion ?
- «Wa alikoum salam», nous vous souhaitons également paix et félicité, vous qui êtes nos sauveurs. Nous vous devons la vie et vous serons éternellement reconnaissants pour cet acte et pour votre si généreuse hospitalité dans ce merveilleux endroit. Nous venons du Muntuland, un pays bien au sud du Sahara. Nous sommes tous musulmans ; nous sommes vos frères en religion, par la grâce d’Allah, le Tout-puissant, le Tout-miséricordieux. Massogui Sala avait ainsi répondu au Cheikh, au nom de tout le groupe.
Après les salamalecs d’usage, les discussions roulèrent sur les situations économiques et politiques qui prévalaient, diversement de part et d’autre de la ligne de démarcation entre l’Afrique du nord et l’Afrique subsaharienne. L’on s’inquiéta, à juste raison de l’exacerbation de la crise économique qui asphyxie, à quelques rares exceptions près, les pays qui constituent cet immense espace, un demi-siècle plus tôt sous domination française, britannique, portugaise et espagnole.
Mouhamed Ben Abdallah interrogea ensuite ses hôtes sur les raisons qui les avaient amenés dans leur périlleuse aventure à travers le désert, juste pour alimenter la conversation. Par expérience, il savait bien que les jeunes gens qui empruntaient cette voie n’avaient qu’un seul but, atteindre l’eldorado européen, à tout prix.
Courtoisement, le Cheikh les écouta s’épancher sur la misère qu’ils étaient en train de fuir et sur les opportunités d’en sortir avec les leurs que le travail et la vie en Europe allaient leur assurer, comme à bien d’autres avant eux. Il resta pensif un bon moment, tirant de sa pipe en cuivre pareille à un porte-cigarette, des bouffées de fumée à l’odeur âcre qu’il soufflait discrètement.
Quand il reprit la parole, ce fut pour mettre ses jeunes hôtes face à la dure réalité des nombreux écueils qu’il leur restait encore à franchir avant d’arriver au bout de leurs rêves, si tant est qu’ils pussent y parvenir.
Caressant lentement sa barbichette poivre et sel, il leur dit, d’une voix vigoureuse mais posée :
- Voyez-vous mes frères et sœurs, peut-être que certains parmi vous, ne le savent pas encore, mais mon pays, la Libye, est dans un profond chaos, par la faute des Occidentaux ! En lieu et place de la démocratie et des libertés dont ils étaient censés nous faire jouir, conséquemment à la ruine du régime autocratique du Colonel Kadhafi qu’ils ont ignominieusement trucidé, ils nous ont laissé en proie à l’anarchie la plus totale. Des milices et factions, dont des djihadistes ayant fait allégeance à Al-Qaida au Maghreb islamique ou à Daeche, ont pris le dessus sur le gouvernement central qui ne maîtrise plus grand chose. Ils ont mis la main sur une bonne partie de l’énorme arsenal en déshérence du régime défunt. Les armes lourdes et légères qu’ils en ont tirées font l’objet d’un vaste trafic jusqu’au cœur du Sahel. Ici, ils s’en servent pour semer la terreur et le désordre, piller, racketter et rançonner.
- Tout cela nous peine et nous désole, vraiment. Mais nous, nous voulons juste aller jusqu’à Tripoli, ou à tout autre endroit à partir duquel nous pourrions poursuivre notre route vers l’Europe, l’Allemagne, plus précisément. C’est notre destination finale à tous, répondit une voix féminine.
- Jusque-là, vous avez eu de la baraka, la chance de ne pas être tombés entre les mains de ces gens-là. Puisse Allah le Tout-puissant, le Tout-miséricordieux, continuer à vous couvrir de sa protection, chère et brave sœur. Mais vous devez savoir que le chemin qu’il vous reste à parcourir, même s’il n’est plus très long, n’est pas exempt d’écueils. Bien au contraire, hélas ! Je n’en suis pas témoin oculaire, mais des sources sures et de bonne foi m’ont appris que ces hors-la-loi, comme sous Kadhafi, traquent les migrants. Les pauvres gens qui ont la malchance de tomber dans leurs filets sont parqués dans les centres de rétention restés ouverts à Benghazi, Gharyan, et même à Tripoli. Ces bandits les enferment, les hommes comme les femmes, dans de sordides hangars et geôles et les soumettent à des traitements inhumains et dégradants. Et en plus de les assujettir à des travaux forcés à leurs lieux de captivité même, ils louent leurs services à de riches Libyens sur des chantiers de construction, dans l’agriculture et l’élevage. Ces esclavagistes ne leur paient quasiment rien pour leur labeur. Pire encore, ils torturent et violent... Je ne vous raconte pas tout cela pour vous faire peur ou vous décourager, mais uniquement pour que vous sachiez ce qui peut vous attendre plus haut. Maintenant c’est à vous de voir, si vous devez continuer votre route, ou rebrousser chemin. Si vous choisissez l’une ou l’autre option, je vous apporterai mon appui, dans la mesure de mes possibilités. Mais je ne vous conseille pas trop d’aller plus loin...
Les propos du Cheikh semèrent le trouble parmi les jeunes voyageurs. Ils lui dirent qu’ils allaient se retirer pour se concerter sur la décision à prendre. Il leur souhaita de prendre la décision la meilleure pour eux.
Le conciliabule ne dura pas. Leurs positions étaient d’emblée tranchées. Dix gars dont les trois filles restantes se résolurent à retourner sagement chez eux, même si ce n’était pas de gaieté de cœur. Les cinq autres jeunes n’entendirent point revenir sur leurs pas, en si bon chemin.
Ourouma Ndaye et Massogui Sala étaient à la tête de ce petit groupe d’irréductibles. Ils avaient mis de leur côté un Massékou Bengue qui n’était plus que son ombre. Mais, malgré sa lucidité défaillante, il tenait à atteindre son but, réaliser le vœu de sa mère de le voir réussir en Europe, et faire son bonheur et sa fierté, comme tant d’autres avant lui l’avaient fait et continuaient de le faire pour les leurs.
Le Cheikh Mouhamed Ben Abdallah tint promesse. Après leur repos dans l’oued qui avait duré trois jours heureux, ceux qui avaient choisi d’interrompre leur périple allaient être raccompagnés jusqu’à la frontière du Muntuland, par des caravaniers faisant cap vers le Sahel jusqu’aux rivières du Sud. Le Cheikh facilita à Massékou Bengue et à ses compagnons l’embarquement dans un véhicule de transport en commun faisant périodiquement la navette entre Awbari et Tripoli distants d’environ 900 kilomètres. Cela leur prendrait une bonne quinzaine d’heures pour arriver à destination. A pied, une semaine n’aurait pas suffi...
* * *
Vêtus d’amples tuniques bédouines offertes par la famille du Cheikh comme les turbans de la même couleur indigo qui enveloppaient leur têtes, ne laissant apparaître que leurs yeux, les voyageurs impénitents avaient pu joindre Tripoli, sans encombre. Personne ne vînt les déranger au fond du véhicule où ils s’étaient reclus. Leur accoutrement et leur attitude silencieuse ne pouvaient trahir leurs lointaines origines et intentions.
C’est dans ce camouflage de circonstance qu’ils étaient partis à la recherche du passeur, Walid ben Jaafar. On leur avait communiqué son adresse et son numéro de téléphone à leur départ de Makobar. Ce chef de milice enrichi par le racket et le trafic humain, vivait dans une coquette et luxueuse villa sur le front de mer, dans la partie résidentielle de Janzour, une banlieue à une dizaine de kilomètres à l’ouest de la capitale libyenne en pleine déliquescence. Ce n’est pas là-bas qu’il reçut ses clients, mais dans l’arrière salle d’un minable troquet dans le centre-ville.
Walid pesta de colère en voyant le groupe :
- Tonnerre de Dieu ! Vous n’êtes que cinq « oussifs » ! Mais où sont donc les autres ? On m’avait dit que vous n’étiez pas moins de vingt !
Ils lui racontèrent leurs déboires et malheurs, les rencontres avec la grande faucheuse, le désistement du plus grand nombre et les conditions dans lesquelles eux avaient poursuivi le voyage, leur volonté d’aller jusqu’au bout de l’aventure restant intacte.
- Tout ça c’est vos problèmes, « azzi » , les arrêta net Walid. Je vous ai trop attendus. Vous êtes non seulement en retard sur le rendez-vous fixé avec mon correspondant de Makobar, mais encore vous ne faites plus le nombre. Si vous voulez partir demain nuit, il faudra payer les places laissées vacantes par les absents. Sinon vous ne quitterez Tripoli que dans un mois, au plus tôt.
- Mais qu’allons-nous faire pendant tout ce temps-là, s’enquit fiévreusement Massékou Bengue, manifestement au bord d’une nouvelle crise de nerfs, comme si les «démons du désert» n’étaient pas loin de reprendre le dessus sur lui.
- Travailler, beaucoup travailler pour pouvoir vous loger, manger et boire, mais surtout compléter le prix de votre passage sur l’autre rive. Vous avez versé mille cinq cents euros à mon correspondant. Mais entre-temps les tarifs ont augmenté, à la mesure de l’aggravation des risques que nous encourons. Et les embarcations et bons pilotes sont de plus en plus difficiles à trouver. Vous me devez donc 500 euros de plus chacun. Au juste, que savez-vous faire ? leur demanda Walid, pour ponctuer ses vaseuses justifications.
Massékou Bengue, Ourouma Ndaye et Massogui Sala répondirent qu’ils étaient ouvriers du bâtiment. Les deux autres dirent qu’ils n’avaient pas de qualifications particulières.
Walid composa trois à quatre numéros sur son cellulaire. Dans les échanges en arabe qu’il eut avec ses interlocuteurs revenaient souvent des mots anglais, principalement, «black», «migrants », «work» et «money». Il se retourna enfin vers ses visiteurs, un large sourire lui barrant le visage, le sourire de quelqu’un qui apparemment venait de conclure une très bonne affaire.
- Ça y est. Vous avez vraiment une sacrée chance, leur dit Walid. Je viens de vous trouver du boulot. Vous, les trois ouvriers, vous commencez demain, sur le chantier d’un immeuble en construction à Gargaresh, pas loin de chez moi. Vous autres, vous serez, dès demain également, affectés au chargement des camions de marchandises qui partent d’ici pour la Tunisie. Vous faites le travail, moi je m’occupe du reste : la perception de votre paie et le règlement de toutes vos dépenses en termes d’hébergement, de nourriture et d’argent de poche. Voilà!
Il venait en fait de les vendre, tels des esclaves. Par le placement réalisé, il récupérait plus que ce qu’ils étaient supposés lui devoir, toutes charges comprises. Il n’allait leur laisser qu’une poignée de dinars, à peine cent euros chacun, pour un mois de dur labeur, dans la canicule. Mais eux trouvaient que c’était un bon début, les prémices de lendemains qui leur chanteraient bientôt, de l’autre côté.
* * *
Leurs quatre semaines laborieuses bouclées, sonna l’heure de lever l’ancre pour Massékou, ses deux compagnons et une trentaine d’autres Subsahariens avec qui ils vivotaient, dans un sinistre taudis. Walid les avaient fait sortir des lieux et de Tripoli, entassés dans une sorte de fourgon pénitentiaire, de couleur verte, aéré seulement par de petites fenêtres grillagées au-dessus de leurs têtes. Les lumières, bruits et odeurs de la ville qui leur parvenaient à travers ces ouvertures s’étaient estompés au fil du trajet pour ne plus être perceptibles.
La nuit était profonde et silencieuse à leur arrivée sur la plage de Zuwara où leur embarquement pour la Grèce était convenu et préparé. Des ombres vinrent vers eux, sortant d’entre les palmiers dont les feuillages ondulaient sous le peigne d’un vent frais soufflant depuis le large. Soulevant le sable fin, il aveuglait les arrivants qui usèrent de leur keffieh pour se protéger les yeux.
Ils eurent beau les écarquiller, ils ne virent nul embarcadère ou navire aux alentours. Il leur avait été dit qu’ils feraient la traversée à bord d’un ferry, d’une chaloupe tenant bien la mer. Les ombres qu’ils avaient entrevues et dont ils distinguaient plus nettement les formes humaines, s’affairaient plutôt autour d’un zodiac vieillot mais de bonne taille. Sa couleur laissait subodorer qu’il provenait des stocks de l’armée libyenne de l’ère Kadhafi.
Massékou Bengue était déjà terrifié, à la seule vue de la masse d’eau sombre et glauque qui s’étalait devant lui jusqu’à un lointain horizon qu’il ne pouvait situer. Sa tête recommença à lui faire mal, atrocement mal. Il tremblait de tout son corps. Quelqu’un derrière lui, le voyant toujours à l’écart sur la grève, alors que le temps de l’embarquement pressait, le propulsa sans ménagement dans le canot pneumatique. Il y tomba, à la renverse, dans les pommes.
Massogui Sala et Ourouma Ndaye qui avaient suivi la manœuvre ne purent que s’écarter pour faire place à leur ami, entre eux, à l’endroit où ils étaient assis en l’attendant, à la poupe de l’embarcation. Il était toujours évanoui comme si, dans son tréfonds, il se refusait à vivre la suite du voyage. Les grincements et ratés du moteur qui mit du temps à démarrer ne le sortirent pas de sa léthargie.
Le barreur du zodiac était loin de mener sa barque à l’aveuglette. Il se guidait à l’aide d’un GPS militaire et était en permanence en contact par téléphone satellitaire avec ses employeurs et leurs relais de part et d’autre de la Méditerranée. Le vent était tombé, quelque temps après le départ de Zawura. La mer était d’huile, étrangement calme, tout le temps de son pilotage nocturne, sous un firmament sans lune éclaboussé d’étoiles sous sa voute d’ébène.
Vers midi, les passagers du zodiac étaient loin des rives libyennes. Leur pilote se gardait de s’approcher de la côte italienne. Il ne fallait pas tomber dans les filets des contrôleurs de la migration plus présents là qu’ailleurs. Le mur libyen s’étant effondré avec Kadhafi, c’est en pleine mer et vers les plages italiennes qui étaient les plus fréquents points de chute des clandestins que l’offensive européenne contre l’immigration africaine s’était recentrée et était plus virulente.
Elle était par ailleurs très sélective. Intransigeante envers les clandestins subsahariens, l’Europe l’était bien moins envers les Syriens et les Irakiens qui fuyaient la guerre et les violences meurtrières entre le marteau de Daeche et d’autres factions fondamentalistes ou en rébellion politique et l’enclume d’airain de Bachar El Assad. Mais ceux-là mériteraient-ils d’être mieux accueillis et traités que les hères africains confrontés à l’âpreté de situations économiques et naturelles, voire politiques, catastrophiques et poussés à franchir les frontières pour survivre et aider les leurs à mieux être ?
Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans l’un et l’autre cas, l’Occident était à l’origine des situations chaotiques qui prévalaient dans les régions que fuyaient les migrants. Les flux migratoires vers l’Europe sont la conséquence de la rémanence destructrice de son œuvre coloniale et de la montée en puissance de la stratégie occidentale d’accaparement des richesses du reste du monde, sous le fallacieux prétexte d’imposer la démocratie et le respect des droits humain partout.
«Est bien loin, comme l’écrivit alors un journaliste dans une gazette muntulandaise, le temps où, pour se reconstruire et restaurer sa puissance et sa vitalité économique, au lendemain de la seconde guerre mondiale et bien après les « trente glorieuses », l’Europe occidentale avait largement ouvert ses frontières, usines et chantiers aux travailleurs ressortissant des anciennes colonies d’Afrique. Aujourd’hui qu’ils n’ont plus besoin des descendants de ces «taillables et corvéables » presque à merci, tous se barricadent derrière des frontières de plus en plus étanches.
En fait l’option européenne était plutôt pour une immigration sélective, dans le cas d’espèce en faveur des Levantins. Ils ont l’avantage d’arriver avec, pour un bon nombre, des compétences et aptitudes avérées et des comptes bancaires offshore garnis. Et d’être beaucoup plus faciles à intégrer que les Noirs, au sein de populations vieillissantes et qui avaient un besoin vital de sang neuf, pour se régénérer et se renouveler. »
Mais, hier comme aujourd’hui, poursuivait le journaliste, « ce n’est pas en rehaussant les barrières à ses frontières méridionales ou en adoptant des positions discriminatoires que l’Europe va pouvoir endiguer le flot des migrants africains vers ses villes et ses vertes prairies. Ils continueront à déferler par tous les moyens, et plus l’ostracisme grandira envers eux et leurs frères déjà installés, plus l’Occident s’exposera à l’implosion».
* * *
Soudain la tempête. L’embarcation était au cœur de la Méditerranée, à une centaine de miles des îles grecques de Cythère et d’Anticythère, quand elle fut prise dans la tourmente. Sous la poussée du vent violent qui soufflait, la mer se soulevait, formant des vagues qui pouvaient atteindre la hauteur d’un immeuble de trois étages.
Terrifiantes, elles firent définitivement basculer Massékou Bengue dans la démence. Elles lui apparaissaient sous l’image de dragons maléfiques, réincarnant les mêmes démons qui avaient commencé à le traumatiser dans le désert.
La houle portait très haut la frêle embarcation, tel un fétu de paille, pour la laisser rudement s’abattre à la surface de la mer. Les voyageurs s’accrochaient les uns aux autres, aux sangles et armatures du zodiac. Il se retourna à plusieurs reprises. L’eau n’était pas glaciale, mais très froide. A rude épreuve, les corps et les esprits finirent par se fatiguer et s’engourdir. Beaucoup lâchèrent prise. Personne ne portait de gilet de sauvetage.
Quand le calme revint, au soleil couchant, il n’y avait plus qu’une dizaine de personnes toujours accrochées au bateau pneumatique. Massékou Bengue en faisait partie. Tremblant d’effroi et de froid, les yeux clos mais les poings malgré tout solidement serrés autour de la rugueuse corde enroulée autour de son bras qui le rattachait à l’embarcation, il avait survécu au naufrage.
Autour de lui flottaient des corps inertes, les cadavres d’autres compagnons de malheur qu’il se refusait de regarder. Ils ne tardèrent d’ailleurs pas à disparaître, engloutis par les flots pour être, plus tard, rejetés sur une rive africaine ou européenne de la Méditerranée. S’ils échappaient aux carnassiers marins...
Poussés par un vent plus calme, ballotés par des vagues moins rudes, le canot et ses survivants allèrent vers l’incertain. Cela dura des heures et des heures d’indescriptibles souffrances.
La peur au ventre, ces rescapés en instance de vie ou de mort avaient terriblement mal. Ils avaient atrocement faim, soif et froid à en mourir à tout instant. Musulmans, pour la plupart, ceux qui avaient encore à l’esprit des versets de coran protecteurs appris et récités depuis leur prime enfance, les psalmodiaient encore et encore, péniblement, du bout de leurs lèvres gercées et de leurs langues pâteuses.
Un énorme récif aux aspérités tranchantes mit fin à leur dérive. Brutal, le choc fit éclater en mille morceaux ce qui restait du zodiac. Les naufragés qui lui étaient toujours accrochés furent violemment désarçonnés et repoussés plus à l’arrière, comme si le grand bleu refusait de les laisser sortir de son piège abyssal.
Bien qu’à l’article de la mort ils réussirent, dans un ultime et décisif sursaut individuel, et en s’aidant mutuellement dans l’effort, à gagner l’étroite mais longue plage mi-sablonneuse, mi-rocailleuse qui s’étalait devant eux, à quelques brasses de l’endroit de leur échouage où l’eau était encore d’une profondeur dangereuse.
Ils étaient parvenus à Cythère. Cythère, c’est cette île «triste et noire» où Baudelaire n’avait «trouvé debout qu’un gibet où pendait [son] image». Ce rocher maudit fut leur premier contact avec l’Europe, avec une «terre promise», ou plutôt rêvée.
La nuit était tombée depuis bien longtemps. Mais la plage, arrière-cour d’une enfilade d’hôtels, était abondamment éclairée.
Les derniers vacanciers à quitter les lieux avaient vu le canot s’éclater sur le rocher, et ses malheureux passagers s’arracher désespérément des eaux. Certains se précipitèrent, sans hésiter, à leur secours. D’autres appelèrent à la rescousse les services sanitaires et médicaux qui ne tardèrent pas à arriver, toutes sirènes dehors, sans doute habitués à ce genre d’opérations, eu égard à la fréquence des naufrages de migrants dans la zone.
Spontanément, des insulaires mis au courant de la catastrophe offrirent de la nourriture, de l’eau et des vêtements chauds aux miraculés. Leur évacuation sanitaire fut diligentée, par hélicoptère médicalisé, sur l’hôpital de niveau trois de Tripoli. Tripoli au centre de la presqu’île grecque du Péloponnèse, et non Tripoli en Libye. Quelle désopilante homonymie !
De tous les cas, celui de Massékou Bengue était le plus sérieux. Les soins intensifs dont il avait bénéficié avec ces camarades l’avaient certes sauvé d’une mort certaine, tant son degré d’inanition et d’hypothermie avait frisé l’extrême. Il restait que sa schizophrénie aggravée l’avait rendu particulièrement dangereux dans son comportement envers les personnes qui l’approchaient, aussi bien ses compatriotes que ceux qui s’activaient pour son salut.
Sitôt remis d’aplomb, c’est comme si sa force naturelle s’était décuplée. Hurlant à pleins poumons qu’il était entouré et assailli par des démons maléfiques, il se montra d’une violence inouïe contre toute forme humaine à sa proximité.
Il fallut le sangler dans une camisole de force pour l’amener à bord d’une ambulance jusqu’à Athènes, l’y interner, en attendant son expulsion. Les autres n’avaient pas été logés à meilleure enseigne. C’est en effet menottés qu’ils embarquèrent tous, une semaine après leur regroupement, dans la capitale grecque, dans le même avion, pour la même destination : la case-départ de leur odyssée infernale.
* * *
Assita Bambado n’avait pas été au marché, ce matin-là. Depuis des jours, de sourdes douleurs la tenaillaient. Tout son corps lui faisait mal. Elle avait d’épisodiques élancements au cœur et migraines. Elle envoya Fabineta, sa fille, s’occuper de son étal au marché et alla reprendre place dans son lit, espérant qu’elle ne tarderait à se sentir mieux.
Assurément, cette dame vieillissante supportait de moins en moins le poids de l’âge accentué par les affres du quotidien. Mais ses souffrances physiques et ses peines de cœur avaient plutôt empiré, parce qu’elle était restée de longues semaines sans recevoir de nouvelles de Massékou Bengue, pas le moindre message.
Par les temps qui couraient, même dans le moindre bourg africain, l’exception c’était de ne pas posséder un téléphone cellulaire. La maison n’avait toujours pas accès à l’électricité. Mais Assita n’en avait pas moins son portable. Quand elle ne le faisait pas recharger chez une voisine, elle l’avait en permanence à portée d’oreille. A chaque fois que retentissait son bruyant timbre, les battements de son cœur s’accéléraient. Mais ce n’était jamais l’appel qu’elle attendait.
Et à chaque fois, elle se sentait encore plus mal, avec le douloureux sentiment que la situation dans laquelle se trouvait son fils aîné n’était pas étrangère à sa souffrance. Dans ses rêves, ses cauchemars plutôt, il lui apparaissait toujours dans des tourments.
Assita s’était assoupie, peu après s’être remise au lit, mais pas pour longtemps. Des bruits de pas et de voix venant de la cour l’arrachèrent brutalement des bras de Morphée dans lesquels elle venait à peine de tomber. Elle se leva péniblement, s’assit sur le bord du lit le temps de reprendre ses esprits et sortit lentement de la chambre.
Quand elle vit le spectacle offert à ses yeux, dans la cour, elle perdit immédiatement ses moyens. Elle se serait lourdement effondrée par terre si quelqu’un ne s’était pas précipité pour la retenir prestement et la soutenir jusqu’à ce qu’elle pût s’asseoir sur un banc. Son fils aîné était là, devant elle, hirsute et hagard, le visage ténébreux, marchant tel un zombie. Elle pleura comme jamais avant, depuis la mort de son époux.
Massékou Bengue l’avait quittée, cinq mois plus tôt, resplendissant de santé et d’espoir. Le voilà revenu en loques, le corps et l’esprit mis en lambeaux par les rudesses d’une épreuve aventureuse sans issue, la désillusion et le désespoir. Assommé par les tranquillisants qui lui étaient administrés depuis son internement hospitalier en Grèce, le garçon était impavide et amorphe.
Lui et ses autres compagnons de la galère, avaient été débarqués à l’aéroport international Patrice Lumbumba de Makobar par le premier avion de la journée en provenance d’Athènes. Sous surveillance policière, ils avaient été mis dans un autocar et raccompagnés, l’un après l’autre, jusqu’à leur adresse déclarée.
Le retour impromptu de Massékou Bengue, dans l’état où il était, confirmait les angoisses prémonitoires d’Assita Bambado. Quand on lui raconta les turbulences physiques et psychiques qu’il avait traversées, elle les assimila aux maux dont elle avait elle-même souffert, durant son absence, comme une mère peut partager les douleurs de l’enfant qu’elle porte en son sein, dans son ventre.
Passé le choc éprouvant de ces retrouvailles dans d’aussi peu souhaitables conditions, Assita se ressaisit. Elle mit les malheurs qui s’étaient abattus sur Massékou et, incidemment, sur elle et toute sa famille, au compte de la volonté divine. Convaincue que pire encore aurait pu leur arriver, que le meilleur comportement que puisse adopter un vrai croyant est de toujours accepter le décret divin, elle se confondit en prières et en remerciements à l’endroit de son seigneur tout-puissant.
Heureuse d’avoir retrouvé son fils vivant quel qu’en fût l’état, ragaillardie par sa foi inébranlable en Dieu, Assita avait retrouvé goût à la vie et surtout au travail. Sa santé s’étant rapidement améliorée, elle avait repris le chemin du marché. Il lui fallait être plus active que par le passé, pour trouver le moyens de rembourser les dettes contractées pour le voyage de Massékou, assurer l’ordinaire de la maisonnée et .... faire partir Ngouda, le jeune frère de Massékou.
C’était on ne peut plus paradoxal, mais sa religion était faite. Si Massékou n’avait pas pu franchir le Rubicon mais lui était néanmoins revenu, vivant, c’est parce que ce n’était pas lui le fils choisi par Dieu, croyait-elle. Elle faisait ainsi un parallèle entre l’émigration avortée de Massékou et le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam, une affaire d’élu, d’appelé. Il lui fallait donc corriger l’erreur commise, en faisant «voyager» son autre enfant, comme d’autres le faisaient et continuaient de le faire.
La conviction ancrée en elle que la réussite n’était pas possible autour d’elle mais dans l’ailleurs lointain, elle la partageait, à travers l’Afrique, avec de nombreux autres pères et mères de famille. N’y pouvaient quasiment rien les fréquentes campagnes de sensibilisation déroulées pour raisonner les parents et leurs rejetons candidats à l’émigration clandestine, pour leur ouvrir les yeux sur les grands risques encourus, du début à la fin de leur odyssée, dans le désert, en mer et sur le sol européen, des espaces pouvant à tout instant être des linceuls pour les espoirs et les illusions du grand nombre.
* * *
Ce soir, comme tous les soirs depuis son retour, Massékou Bengue rugissait et tonnait contre les esprits malins qui continuaient à lui polluer l’existence et qu’il était seul à voir et entendre. Cette fois encore, quand la nuit devint froide, Assista Bambado s’était levée pour de cabalistiques rituels païens et musulmans. On lui avait assuré que la pleine guérison de Massékou et le succès du projet qu’elle nourrissait pour Ngouda dépendaient de son abnégation dans ses libations et prières. Et nul ne pouvait lui faire croire le contraire...
(*) Extrait de : Amadou FALL : Il était une fois au Muntuland - Nouvelles. Edilivre 2017.
A découvrir aussi
- La numération en langue nationale- Par Cheikh FALL *
- L’enfant et la mer - Par Fara SAMBE *
- Première pluie - Par Fara SAMBE *
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 96 autres membres